✖
Entrez vos coordonnées et un agent Homki vous rappelera gratuitement
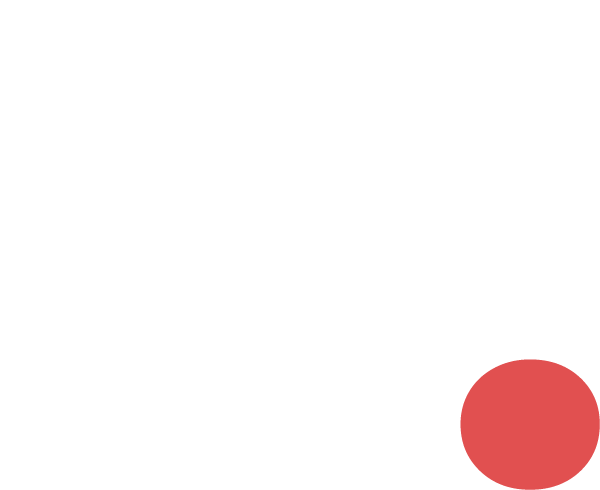 Notification
Notification
Votre demande a été bien enregistrée.
Les investissements immobiliers indirects séduisent de plus en plus d'épargnants en quête de diversification patrimoniale. Les SCPI (société civile de placement immobilier) et les OPCI (organisme de placement collectif immobilier) représentent deux options majeures pour investir dans la « pierre-papier », avec des caractéristiques bien distinctes.
Si les SCPI investissent jusqu'à 100 % dans l'immobilier, les OPCI combinent actifs immobiliers et placements financiers. Quelles sont les particularités de chaque solution ? Comment choisir le véhicule d'investissement le plus adapté à votre stratégie patrimoniale ? Homki vous guide dans la compréhension de ces deux placements.
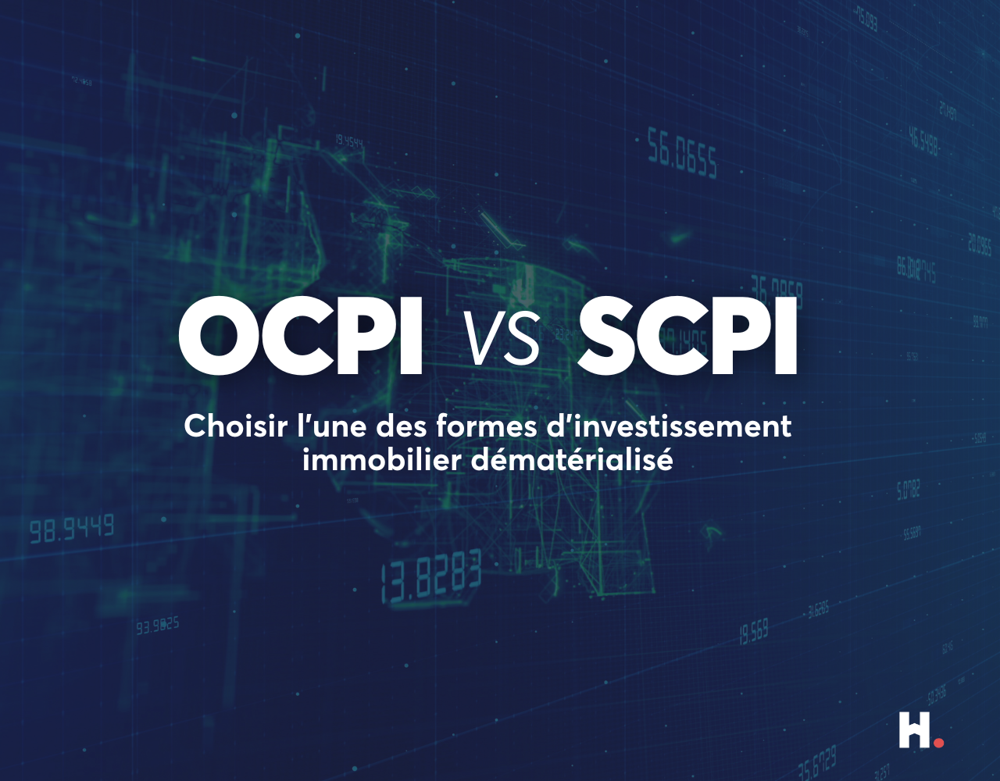
La « pierre papier » représente une forme d'investissement immobilier dématérialisé permettant d'acquérir des parts de sociétés qui gèrent un patrimoine immobilier, sans posséder directement les biens. Cette méthode offre aux investisseurs la possibilité de placer leur épargne dans l'immobilier à partir de quelques milliers d'euros.
Les sociétés de gestion spécialisées se chargent de l'acquisition, de la location et de l'entretien des biens. Les revenus générés sont ensuite redistribués aux détenteurs de parts sous forme de dividendes, proportionnellement à leur investissement. La liquidité des parts varie selon le type de placement : plus rapide pour les OPCI que pour les SCPI.
Le marché de la pierre papier s'organise autour de deux véhicules principaux : les SCPI, focalisées sur l'immobilier, et les OPCI, qui associent immobilier et valeurs mobilières. Ces placements s'effectuent via un compte-titres ou un contrat d'assurance-vie, avec des durées de détention recommandées supérieures à 8 ans.
Les SCPI se distinguent par leur allocation patrimoniale exclusivement dédiée aux actifs immobiliers. Cette caractéristique fondamentale permet une mutualisation des risques grâce à la diversification du portefeuille sur différents types de biens. Le rendement locatif provient des loyers collectés, versés aux souscripteurs sous forme de dividendes trimestriels.
À la différence d'autres placements, les SCPI offrent un effet de levier intéressant grâce à la possibilité d'investir à crédit. Le marché secondaire assure une certaine liquidité des parts, bien que le placement soit conçu sur le long terme. Les performances dépendent notamment de la stratégie d'acquisition et du taux d'occupation des biens, avec un horizon d'investissement recommandé supérieur à 8 ans.
La délégation totale de la gestion locative représente un atout majeur pour les investisseurs. Un professionnel agréé par l'Autorité des Marchés Financiers prend en charge la sélection des locataires, l'encaissement des loyers et la maintenance des biens. Cette formule permet d'éviter les contraintes administratives et techniques liées à un investissement direct.
Les sociétés de gestion appliquent des frais oscillant entre 8 % et 12 % des loyers perçus pour assurer ces prestations. Ces honoraires, déductibles de la tranche marginale d'imposition, couvrent notamment la gestion quotidienne du patrimoine et les relations avec les locataires. Le taux d'occupation moyen des SCPI en 2025 atteint 93 %, témoignant de l'efficacité de cette gestion professionnalisée.
La protection des épargnants investissant en SCPI repose sur un cadre réglementaire strict supervisé par l'Autorité des Marchés Financiers. Cette instance délivre les agréments aux sociétés de gestion et assure un contrôle rigoureux de leurs activités tout au long de la vie des SCPI.
Les sociétés gestionnaires doivent prouver leurs compétences techniques et financières avant d'obtenir l'autorisation d'exercer. L'AMF veille également à la transparence des informations communiquées aux investisseurs, notamment via l'examen des documents commerciaux et des rapports périodiques.
La note d'information visée par l'AMF constitue un document essentiel détaillant la stratégie d'investissement, les frais et les risques associés. Cette régulation stricte participe à la sécurisation du marché des SCPI, établissant un cadre propice à la confiance des épargnants.
Contrairement aux SCPI, les OPCI partagent leurs investissements entre l'immobilier et les produits financiers. La loi exige qu'au moins 60% des investissements soient consacrés à l'immobilier, tandis que jusqu'à 35% peuvent être placés en produits financiers.
Le reste du portefeuille se compose d'une réserve de liquidités obligatoire de 5 %, garantissant la capacité de rachat des parts. Cette combinaison permet de profiter à la fois des revenus locatifs stables et des opportunités des marchés financiers.
Les OPCI se structurent sous deux formes juridiques distinctes :
La fiscalité appliquée diffère selon le véhicule choisi. Les revenus des SPPICAV sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30 %, tandis que les FPI relèvent du régime des revenus fonciers avec impôt sur le revenu et prélèvements sociaux. Les délais de rachat des parts varient également : deux mois maximum pour une SPPICAV contre un horizon plus long pour un FPI.
La liquidité accrue des parts constitue un avantage majeur des OPCI grand public par rapport aux autres placements immobiliers. Une poche de trésorerie minimale de 5 % garantit aux épargnants la possibilité de récupérer leur capital dans des délais maîtrisés.
Le fonds peut moduler le prix de retrait en fonction de la valeur liquidative, calculée généralement tous les 15 jours. Cette fréquence de valorisation, associée aux actifs financiers plus liquides, facilite les opérations d'achat et de vente pour les porteurs de parts.
La réglementation prévoit néanmoins des mécanismes de protection contre les retraits massifs. Les sociétés de gestion peuvent activer des gates, limitant temporairement les rachats pour préserver l'équilibre du fonds en cas de forte demande de sortie des investisseurs.
La stratégie patrimoniale optimale varie selon le profil de l'investisseur. Les SCPI séduisent par leur rendement stable et leur exposition pure à l'immobilier, avec des distributions régulières de revenus locatifs. Les OPCI, grâce à leur diversification entre immobilier et marchés financiers, offrent une meilleure réactivité aux cycles économiques.
Les points communs entre ces deux véhicules résident dans leur accessibilité et leur gestion déléguée. Un ticket d'entrée modéré permet d'accéder à un patrimoine diversifié, tandis que des professionnels agréés assurent la gestion quotidienne.
Le choix dépend avant tout de vos objectifs : recherche de revenus réguliers pour les SCPI, potentiel de plus-value pour les OPCI. La durée d'investissement et la tolérance au risque guident également la décision - un horizon long terme favorise les SCPI, une flexibilité accrue privilégie les OPCI.
Les données de l'ASPIM révèlent des trajectoires contrastées entre SCPI et OPCI sur la période 2020-2024. Face à la crise sanitaire, les SCPI ont maintenu un rendement stable autour de 4,18 % en 2020, puis 4,45 % en 2021. Les OPCI ont connu une volatilité plus marquée : -1,54 % en 2020, avant un rebond à 3,75 % en 2021.
La diversification des OPCI s'est avérée pénalisante durant les périodes de turbulences boursières. Le premier semestre 2024 confirme cette tendance avec une baisse de -3,1 % pour les OPCI, tandis que les SCPI conservent un taux de distribution moyen de 4,5 %. Les SCPI « bureaux » enregistrent un recul de -13,2 % de leur valeur de réalisation par part en 2023, contre -7,6 % pour la catégorie « commerces ».
Les revenus distribués aux associés sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de 17,2 %. Deux options s'offrent aux détenteurs de parts : le régime micro-foncier avec un abattement forfaitaire de 30%, ou le régime réel permettant la déduction des charges.
Le micro-foncier s'applique uniquement si les revenus fonciers annuels restent inférieurs à 15 000 €, sans bénéficier d'un dispositif fiscal spécifique. Le régime réel autorise la déduction des intérêts d'emprunt et des frais de gestion, mais exige une déclaration plus détaillée.
Les plus-values réalisées lors de la revente des parts sont taxées selon un système d'abattements progressifs : exonération totale d'impôt après 22 ans de détention, et des prélèvements sociaux après 30 ans.
Les revenus distribués par les OPCI sous forme de SPPICAV bénéficient du prélèvement forfaitaire unique de 30 %, une fiscalité plus légère que celle des revenus fonciers classiques. Un atout majeur pour les investisseurs souhaitant optimiser leur imposition sur le long terme.
La détention via un contrat d'assurance-vie renforce cet avantage fiscal. Les plus-values et revenus profitent alors du cadre privilégié de l'assurance-vie, avec une taxation dégressive selon la durée de détention et un abattement annuel sur les retraits après 8 ans.
Les FPI conservent quant à eux le régime des revenus fonciers, mais permettent de bénéficier des dispositifs de défiscalisation immobilière classiques comme l'amortissement des biens. Cette flexibilité fiscale permet d'adapter sa stratégie patrimoniale selon sa situation personnelle.
Les parts de SCPI et d'OPCI entrent dans le calcul de l'IFI selon des modalités spécifiques. La valeur à déclarer correspond au montant communiqué par la société de gestion, représentant la quote-part d'actifs immobiliers au 1er janvier 2025.
Une distinction s'opère entre les OPCI et les SCPI. Pour les OPCI, seule la fraction immobilière est assujettie, excluant la poche financière et la trésorerie. Les SCPI voient leur valeur intégralement taxée, sauf pour la part de liquidités nécessaire à leur fonctionnement.
La détention de parts via un PER assurance ouvre droit à une exonération totale d'IFI depuis 2023, créant une opportunité d'optimisation patrimoniale pour les investisseurs soumis à cet impôt.
L'accessibilité accrue via l'assurance-vie constitue un atout majeur pour ces placements immobiliers. Les frais de souscription s'avèrent plus avantageux qu'en direct : 6-7 % en moyenne contre 10-12 % pour une acquisition classique. La valorisation des parts bénéficie d'une actualisation régulière, facilitant les arbitrages.
Le choix des supports reste néanmoins encadré par les assureurs. Les meilleurs contrats proposent une quarantaine de supports immobiliers en 2025, permettant une réelle diversification. À noter que les versements sur ces unités de compte sont généralement plafonnés à 50 % de l'encours total.
La distribution des revenus varie selon les contrats. Certains assureurs reversent 100 % des loyers perçus, d'autres se limitent à 85-90 %. Un système de réinvestissement automatique des revenus peut également être proposé pour capitaliser sur le long terme.
Les Sociétés d'Investissement Immobilier Cotées (SIIC) représentent une troisième voie d'investissement dans la « pierre-papier ». Ces sociétés foncières, cotées en bourse, acquièrent et gèrent un patrimoine immobilier destiné à la location.
La cotation boursière des SIIC les distingue fondamentalement des SCPI et OPCI. Cette caractéristique apporte une liquidité quotidienne mais expose l'investisseur à une volatilité accrue des valeurs. Les variations peuvent atteindre 20% à la hausse comme à la baisse sur une année.
Les SIIC doivent distribuer 85 % de leurs revenus locatifs aux actionnaires sous forme de dividendes. Un atout majeur pour les investisseurs recherchant des rendements réguliers, avec une fiscalité attractive proche de celle des SPPICAV.